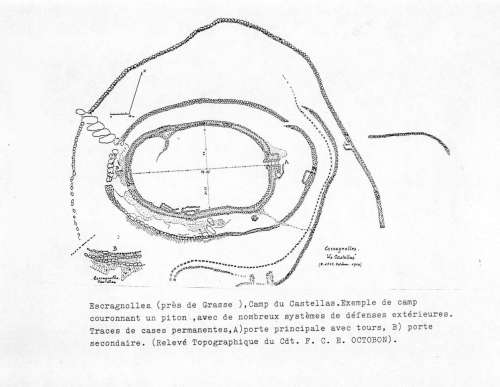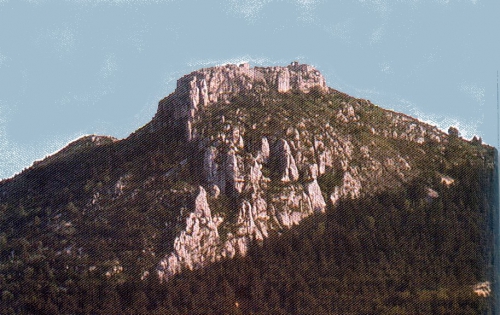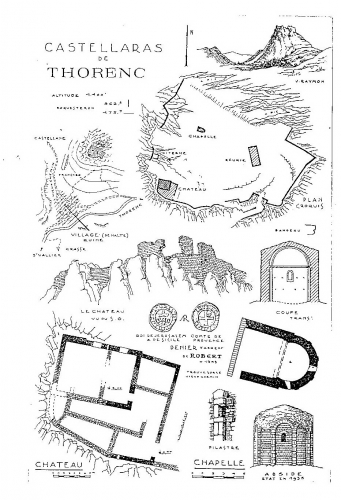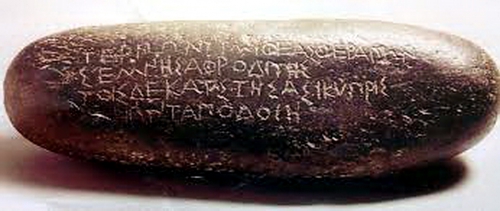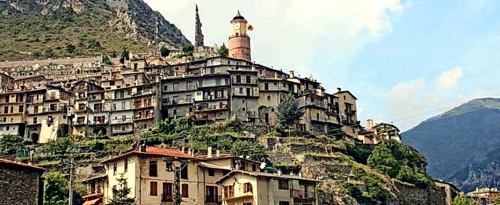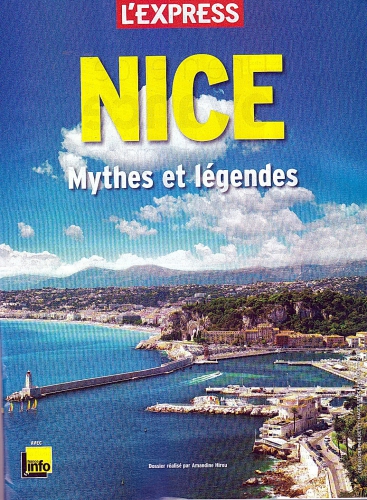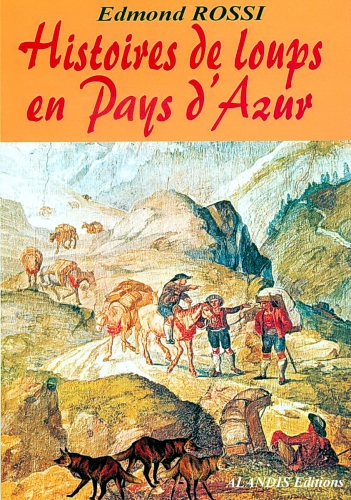Les pouvoirs du sorcier et de la masca sont multiples et ambivalents et quelquefois spécialisés.
La magie offre la possibilité de soumettre et de détruire, mais aussi de protéger et de sauver. Si le sorcier ou la masca est capable d'envoûter et de jeter un sort, d'obtenir certaines faveurs par des sortilèges ou des enchantements, de deviner comme de guérir, ils peuvent tout aussi aisément neutraliser l'influence d'un concurrent.
Les plus anciens, chargés d'expérience, possèdent plus d'autorité et de puissance. Dans cette rivalité où s'affrontent forces occultes manipulées par des initiés, certains secrets et une évidente pratique sont les meilleures gages du succès.
Exerçant leur talent dans la vie quotidienne, comme dans l'exceptionnel touchant au domaine du fantastique et de l'imaginaire, les actes de magie et de sorcellerie peuvent se classer en quatre catégories : les sorts et les envoûtements, les enchantements et sortilèges, la divination et la guérison. Le dernier point qui rejoint la médecine traditionnelle sera inclus à cette dernière.
SORTS ET ENVOUTEMENTS
Les possibilités d'action sont nombreuses en fonction du but poursuivi. Les mascas peuvent causer le malheur des gens et des animaux pour leur seule satisfaction.
Pour atteindre la victime choisie, il faut d'abord la transférer dans une représentation symbolisée par une poupée ou un cœur de cire. Ce support sera ensuite piqué à l'aide d'aiguilles ou soumis à des coups de couteau ou de toute autre arme, en prononçant des formules magiques.
La personne ou la bête ainsi visée sera frappée indirectement, elle sera blessée, atteinte dans sa chair et pourra même mourir.
Dans l'Est du Comté de Nice, la masca posait sur un petit feu un pot rempli d'eau et après avoir nommé la personne, elle invoquait le diable à trois reprises et infligerait une infirmité particulière en répétant : "Je te fais et je te refais".
Autre pratique niçoise, celle qui consiste à placer un balai renversé derrière la porte ou la fenêtre de la victime désignée, puis à introduire un de ses cheveux dans un œuf, quand celui-ci pourrit elle tombera malade.
Mais ces rituels sont souvent superflus, il suffit tout simplement que la masca touche sa victime, qu'elle la regarde ou serre dans sa main un objet lui appartenant pour que le maléfice s'opère.
Malédiction jetée publiquement, animaux envoûtés qui dépérissent bizarrement, nombreux sont les exemples illustrant des démarches de ce type. Les pratiques observées tiennent compte de plusieurs facteurs : le lieu, le moment choisi, les objets nécessaires et les formules à réciter.
Dans le Comté de Nice, on admet que la masca opère plus efficacement à jeun. Curieusement, la même abstinence est recommandée aux médiums opérant dans des séances de spiritisme. Si Pâques est une période propice aux envoûtements en Provence, minuit reste l'heure des sorcières et des mauvais esprits, mais on pratique également à l'aube. Les mascas exercent aussi bien leurs talents chez elles que dans les cimetières ou à la croisée de plusieurs chemins.
Le contact avec la victime, s'il s'opère, doit privilégier la chevelure. Les nœuds faits avec un vêtement, un cheveu, une corde pour enrouler un objet personnel sont autant de moyens de parvenir à ses fins.
Mais parfois, un simple regard suffit à jeter le mauvais sort. L'expression "donner le mauvais œil" est à cet égard très significative. La personne ou l'animal visé tombe alors sous le charme.
Pour éviter de provoquer la jalousie, cause de ce type de vengeance, les paysans méfiants évitent de donner le nombre de leurs moutons, de leurs vaches ou de leurs ruches, les quantités récoltées, protégeant ainsi leurs biens du "mauvais œil".
Bien souvent secrètes, les formules citées viennent des grimoires colportés jadis. Il s'agit souvent de prières transmises oralement et qui se sont ainsi transformées et quelquefois altérées au fil du temps. Les gestes et les signes qui accompagnent le rite relèvent des mêmes origines. Parmi les gestes retenus, signalons le fait de tenir un doigt contre le palais, faire les cornes ou agiter un couteau en l'air.
Les secrets se transmettent parfois la nuit de la Saint Jean et en pleine campagne.
Les pouvoirs du sorcier ou de la masca s'exercent aussi bien sur les événements du cours normal de la vie pour les gêner ou les entraver, que d'une manière plus extraordinaire touchant au fantastique d'une magie de haut niveau.
Dans le premier registre des choses banales, nous retiendrons l'arrêt d'un attelage et aujourd'hui d'une automobile. Cette inexplicable immobilisation d'un véhicule est signalée dans les Alpes comme en Provence.
Citons également la capacité des sorcières à provoquer des chutes causant des accidents ou renversant des véhicules, par la seule magie de pierres ou d'autres obstacles déposés sur les routes et les chemins.
Toutes les contrariétés rencontrées par le paysan dans sa vie de tous les jours ont souvent été imputées aux maléfices distillés par la sorcellerie : attaques contre les animaux de la ferme ou de la basse-cour, dommages aux récoltes, gêne dans le travail, temps désastreux ainsi que tout ratage concernant la préparation du lait caillé, du vin, du pain, de la lessive, des salaisons, de la fécondation du bétail. A ces ennuis, encore présents dans la mémoire et liés au "mauvais sort", s'ajoutent ceux causés aux enfants.
Cela débute par le bizarre tarissement du lait de la nourrice ou encore le refus de la tétée par le nourrisson. Pour rompre ce maléfice, il suffisait de porter l'enfant hors du village et d'offrir un pain à la première personne rencontrée. Si le cadeau était accepté, l'enfant guérissait.
Autrefois, la mortalité infantile était élevée à cause de l'absence d'hygiène et des épidémies, aussi les sorcières étaient-elles rendues responsables des maladies et des malheurs des enfants.
Le regard d'une masca, des friandises offertes suffisaient à envoûter le bébé que les mères s'efforçaient de protéger grâce à des talismans tels qu'un sachet de sel ou un morceau de cierge béni, accroché au berceau. Lorsqu'on emmaillotait le petit être, on faisait le signe de la croix sur les langes et on pinçait le nez du bébé pour faire la nique à la masca !
Un test simple permettait de savoir si l'enfant avait été "emmasqué" : une soucoupe remplie d'eau posée sur sa tête recevait quelques gouttes d'huile qui ne devaient pas s'agglomérer. De même, on lavait le bébé avec de l'eau bouillie avec de la sauge qui ne devait pas se troubler. Dans le cas contraire, l'eau du bain jetée sur le chemin serait piétinée comme le mauvais sort.
Les sorciers peuvent maîtriser les éléments ou les déchaîner : orage, tempête, vent et pluie leur appartiennent. Nous verrons plus loin les moyens de défense contre ces types de maléfices qui incombent souvent aux curés.
La divination est un domaine où excellent les sorciers et leurs consoeurs. Leur don d'ubiquité comme leur capacité à se rendre invisible témoignent de leur voyage possible dans un monde parallèle où le temps n'a plus de mesure, ils touchent alors aussi bien au présent qu'au futur. Cet aspect sera également examiné à part.
Mais en plus des humains, les sorciers et leurs homologues féminins peuvent diriger les animaux. Certains sorciers sont cités pour leurs dons de charmeurs de serpents. Ils peuvent saisir couleuvres, vipères et lézards verts et les caresser sans crainte.
D'autres en sifflant ou en prononçant certaines paroles attirent les oiseaux qui viennent se poser sur leur épaule. Ces cas sont connus en Provence.
Tout aussi étrange, il faut rappeler le don qu'a la masca de vous égarer, de vous faire perdre votre chemin en utilisant une herbe spéciale dite "herbe d'égarement".
Profitant du sommeil de sa victime, elle peut aussi bien favoriser l'amour que le freiner en rendant impuissant en "nouant l'aiguillette".
Les pouvoirs ambivalents de la sorcellerie peuvent aussi conduire à lever le mauvais sort et à guérir des maux engendrés par ces mêmes pratiques.
D'après les "HISTOIRES ET LÉGENDES DES BALCONS D'AZUR", d'Edmond ROSSI, pour obtenir cet ouvrage contacter: edmondrossi@wanadoo.fr